Festival F’A’A 2025
Filmer l’Art et l’Architecture
Troisième édition
21, 22 & 23 novembre 2025
Atomic Cinéma, Aubigny-sur-Nère
Centre-Val de Loire
Pour sa troisième édition, le Festival F’A’A – festival de cinéma sur l’art et sur l’architecture – poursuit son engagement pour une médiation de l’art par le cinéma. Un programme sans limite de période, qui explore l’histoire de l’art à travers la création cinématographique.
Du vendredi 21 novembre au dimanche 23 novembre, réalisateurs, artistes, historiens d’art, curateurs et critiques présentent et débattent de neuf séances conçues comme autant de parcours à travers les formes et les récits de l’art et de l’architecture. Du regard de l’enseignant, avec un film de László Moholy-Nagy et ses étudiants, à la performance de la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker au Louvre, en passant par une lecture géopolitique d’un film de Andreï Tarkovski par Jean Radvanyi : Les points de vue sont multiples.
Une carte blanche est offerte chaque année à une Capitale Européenne de la Culture. En 2025 nous accueillons Bruxelles, avec le BAFF (Brussels Art Film Festival).
Une séance sera dédiée au territoire et à la Galerie Capazza qui célèbre ses cinquante ans.
Une séance scolaire est également proposée, en présence d’un artiste invité.
EN CONTINU
En face du cinéma, la Galerie François Ier accueille F’A’A hors les murs : projections en accès libre, installation et exposition de films par Léa Pauly et Clara Pouillard, étudiantes de l’ENSA de Bourges.
NAVETTE
Le festival renforce son engagement écologique avec un dispositif de mobilité douce : des navettes gratuites relient le cinéma depuis la gare de Gien (les 21 et 22 novembre et retour le dimanche 23 novembre). Horaires SNCF et lien pour inscription ci-dessous.
Sylvie Boulanger
Directrice de programmation du Festival F’A’A
Mary-Anne de La Palme Présidente de F’A’A
& Jean-Yves Charpin Vice‑Président de F’A’A
Directeurs du programme Territoires











Palimpsest of the Africa Museum, Matthias De Groof et Mona Mpembele, 2019
Do not Disturb, László Moholy‑Nagy, 1945
L’Œuvre Verte, Jean‑Yves Charpin, 2025
Sound???, Dick Fontaine, 1967
Vladimir Zbynovsky, Bérangère Casanova, 2025
Espaces intercalaires, Damien Faure, 2012
Il y a les drapeaux qui flottent, Dominique Petitgand, 2024
Forêt, Evi Cats, avec Anne Teresa De Keersmaeker et Nemo Flouret, 2025
Jean Chatelus. L’œil qui accumule, Alyssa Verbizh, 2025
Andreï Roublev, Andreï Tarkovski, 1966
Werner Nekes à Buenos Aires, Claudio Caldini, 1980
Vendredi
21 novembre
| SÉANCE ● Vladimir Zbynovsky, un film de Bérangère Casanova, 26 min, 2025 Séance présentée par Sophie Capazza, en partenariat avec l’association A.R.T, en présence de Vladimir Zbynovsky et de Julie Raffestin‑Alliche, médiatrice culturelle d'Aubigny‑sur‑Nère. |
| VISITE Visite de l’exposition Galerie François Ier réalisée par Léa Pauly et Clara Pouillard, étudiantes de l’ENSA, l’École nationale supérieure d’art de Bourges. |
| SÉANCE ● Forêt, un film d’Evi Cats, avec Anne Teresa De Keersmaeker et Nemo Flouret, 45 min, 2025 Séance présentée par Pascale Raynaud, en présence d’Evi Cats, en partenariat avec le Musée du Louvre, Rosas, 24 images et le Festival d’Automne à Paris. |
Samedi
22 novembre
| SÉANCE SPÉCIALE TERRITOIRES ● L’Œuvre Verte, un film de Jean‑Yves Charpin, 20min, 2025 Séance présentée par Mary‑Anne de La Palme et Jean Yves Charpin en présence de Laura et Denis Capazza‑Durand. |
| SÉANCE ● Do not Disturb, un film de László Moholy‑Nagy et ses étudiants, 19 min, 1945 Séance présentée par Erik Bullot, en présence de Stefano Miraglia, Arnaud Deshayes, et des étudiants, en partenariat avec l’École nationale supérieure d’art de Bourges (ENSA). |
| SÉANCE ● Espaces intercalaires, un film de Damien Faure, 56 min, 2012 Séance SensoProjekt présentée par Valérie Barot‑Nouzille et Monica Regas, en présence de Damien Faure. |
| SÉANCE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE ● Palimpseste du Musée d’Afrique, un film de Mona Mpembele & Matthias De Groof, 69 min, 2019 Séance présentée par Sarah Pialeprat en partenariat avec le Brussels Art Film Festival (BAFF). |
| SÉANCE ● Jean Chatelus. L’œil qui accumule, un film d’Alyssa Verbizh, 46 min, 2025 Séance présentée par Alyssa Verbizh et Sylvie Boulanger, en partenariat avec Mirage Illimité & la Fondation Antoine de Galbert. |
Dimanche
23 novembre
| SÉANCE ● Sound???, un film de Dick Fontaine, avec Roland Kirk et John Cage, 27 min, 1967 Séance présentée par Anne‑Laure Chamboissier, en présence de Dominique Petitgand. |
| SÉANCE ● Andreï Roublev, un film d’Andreï Tarkovski, 205 min, 1966 Séance présentée par Jean Radvanyi, en partenariat avec le Festival du Film Russe “Une autre Russie”. |
+ Tous les jours
Exposition à la Galerie François Ier de films et vidéos en accès libre
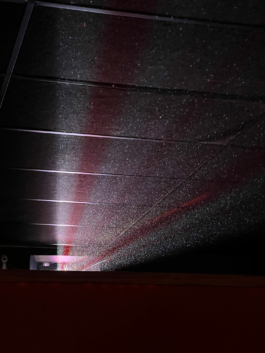







Atomic Cinéma
23 rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère
Centre-Val de Loire
En train (1h30) Paris – Gare d’Austerlitz ou Gare de Lyon ➔ Gien + Navette (45min)
En voiture (2h15) de Paris prendre A6-A77, sortie Gien
En avion de tourisme Aérodrome d’Aubigny-sur-Nère
À pied ou en vélo GR3 – La Loire à vélo (EuroVélo 6)
Navette gratuite F’A’A
Les festivaliers pourront rejoindre Aubigny-sur-Nère depuis la gare de Gien
► ALLER Vendredi 21 et Samedi 22 novembre
Gien ➔ Aubigny-sur-Nère
◄ RETOUR Dimanche 23 novembre
Aubigny-sur-Nère ➔ Gien
Sur réservation dans la limite des places disponibles
Banquet F’A’A
DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Un banquet aura lieu à la Galerie François Ier à midi.
Convivialité : un banquet culturel mis en scène par Louise Arnette*
Le dimanche, les festivaliers sont conviés à un banquet festif à la Galerie François Ier, autour des produits du terroir, en partenariat avec des producteurs locaux. Un moment chaleureux pour prolonger les échanges entre professionnels et publics.
*Diplômée de l’Ensa de Bourges en 2024, Louise Arnette développe une pratique ancrée dans les territoires ruraux qu’elle arpente et interroge à travers le son, l’écriture, le témoignage et l’installation.
Sur réservation dans la limite des places disponibles (Participation libre)
Hébergements
Hôtel La Chaumière
2 Rue Paul Lasnier, 18700 Aubigny-sur-Nère
+33 2 48 58 04 01
Logis Hôtel Auberge la Fontaine
2 Av. du Gén Leclerc, 18700 Aubigny-sur-Nère
+33 2 48 58 02 59
Chambres d’Hôtes
Joindre l’Office de Tourisme Sauldre et Sologne
+33 2 48 58 40 20
Restaurants
à proximité de l’Atomic Cinéma
Pour assurer un repas rapide entre les séances, les restaurateurs recommandent une réservation pour un service à 12h et à 19h. Préciser que vous participez au Festival F’A’A.
Le Cutty Sark (Pub / Brasserie)
29 Rue du Prieuré, 18700 Aubigny‑sur‑Nère
+33 2 48 81 03 96
L’Entrepot’es (Brasserie / Bistrot)
1 Rue des Dames, 18700 Aubigny‑sur‑Nère
+33 2 48 58 86 30
Le Monä (Pizzeria / Italien)
13 Rue des Dames, 18700 Aubigny‑sur‑Nère
+33 6 52 86 20 90
Le Bien Aller (Bistronomie)
3 Rue des Dames, 18700 Aubigny‑sur‑Nère
+33 2 48 58 03 92
Notices des films et séances
SÉANCE
Danser le musée
Filmer la porosité du musée, filmer une performance dansée, offrir aux cinéastes l’opportunité de relever de multiples défis : comment faire dialoguer passé et présent, faire coexister les regards, rendre compte d’un espace pluriel, restituer l’envoûtement de l’éphémère, rendre visible l’invisible, et poreuses les frontières tant spatiales que temporelles.
Séance présentée par Pascale Raynaud, en présence d’Evi Cats, en partenariat avec le Musée du Louvre et Rosas.
Chorégraphie d’Anne Teresa De Keersmaeker et Némo Flouret. Coproductions Rosas, 24 images, Musée du Louvre, Festival d’Automne à Paris, ARTE France.
Tourbillons, forêts en feu, villes effacées : les œuvres d’art séculaires conservées au Louvre résonnent fortement avec notre époque. En 2022, Anne Teresa De Keersmaeker et Némo Flouret ont créé Forêt, dans lequel les galeries italiennes et françaises du Louvre ont été le point de départ d’une réflexion sur les images, en tant qu’outils dans la construction d’un monde. Le projet s’est penché particulièrement sur les questions de seuil et de limite, en relisant les œuvres et l’architecture du lieu à travers des stratégies de changement d’échelle et de contraste, de cadrage, d’excès. Expansion et contraction travaillant les corps, autant que le temps et l’espace.
Evi Cats — Evi Cats (1994) est une cinéaste qui vit et travaille à Bruxelles. Walls That Scream, son documentaire sur les traces de la violence policière à Bruxelles, a été présenté en avant-première à l’IDFA 2022 et a remporté peu après la VAF Wildcard. Son film le plus récent et le plus fictionnel, Waiting For a Sun Storm, aborde la ville (féministe) et ses strates de textures et de temps. Il a remporté le prix du Meilleur court métrage étudiant belge au Film Fest Gent. Depuis 2022, Cats filme régulièrement pour la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker et sa compagnie de danse Rosas.
Anne Teresa De Keersmaeker — Anne Teresa De Keersmaeker crée Asch, sa première chorégraphie, en 1980. Deux ans plus tard, elle marque les esprits avec Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich. En 1983, elle chorégraphie Rosas danst Rosas et établit à Bruxelles sa compagnie Rosas. Elle explore les relations entre danse et structures musicales de toutes les époques et confronte sa pratique chorégraphique aux modèles mathématiques, à la géométrie, à l’étude du monde naturel et des structures sociales. Anne Teresa De Keersmaeker fonde l’école P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) à Bruxelles en 1995 en association avec La Monnaie / De Munt et investit depuis 2015 les espaces muséaux.
Némo Flouret — Originaire d’Orléans, Némo Flouret est chorégraphe et danseur (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, Paris – P.A.R.T.S., Bruxelles). Il développe des projets pour des espaces urbains post‑industriels : 900 Something Days Spent in the XXth Century (2021) ou Ce que l’on a trouvé dans la solitude (2019) qui se déroule dans un tunnel. Depuis 2019, il travaille avec Anne Teresa De Keersmaeker.
Pascale Raynaud — Responsable de la programmation cinéma à la Direction de l’auditorium et des spectacles, Musée du Louvre. Elle y a initié et y programme, notamment, les Journées Internationales du Film sur l'Art, festival annuel sans compétition proposant une sélection de films sur l’art récents ainsi que des cartes blanches, des focus thématiques et des spectacles à la croisée des arts. Elle a participé à la création et est responsable de la collection de films sur l'art du Louvre, qui reconstitue une histoire du documentaire sur l’art depuis ses origines. Docteure en Histoire de l’art / Études cinématographiques, elle est spécialiste du cinéma des premiers temps, notamment du corpus Lumière, et s’intéresse particulièrement à l’émergence du langage cinématographique et aux croisements du cinéma avec l’histoire de l’art et l’archéologie.
SÉANCE SPÉCIALE TERRITOIRES
“Entre murs et Regards” avec la Galerie Capazza
La Galerie Capazza – lieu incontournable de l’art contemporain en Région Centre Val de Loire, dans le Cher. Située en Sologne à Nançay, la Galerie Capazza, patrimoine historique du XVIIe siècle, a été créée en 1975 par Sophie et Gérard Capazza. On peut y découvrir les œuvres de 98 artistes contemporains : céramique, estampe, orfèvrerie, peinture, photographie, sculpture, verre. Depuis une dizaine d’années, la galerie a été reprise par Laura et Denis Capazza-Durand.
Séance présentée par Mary-Anne de La Palme et Jean Yves Charpin en présence de Laura et Denis Capazza-Durand.
Le festival met en lumière la question de l'accrochage des œuvres d’art et son pouvoir de narration. Cette séance s'ancre dans l'histoire singulière de la Galerie Capazza, qui célèbre cette année ses cinquante ans d’existence au cœur de la Sologne. À travers un film et des témoignages, la séance interroge : Que dit un accrochage ? Que nous raconte le lieu qui accueille les œuvres ? Une rencontre sensible entre espace, regard et transmission.
Mary-Anne de La Palme, Présidente de F’A’A – Filmer l’Art et l’Architecture — Mary-Anne de La Palme est productrice. Elle a créé et dirigé Les Films du Grillon et MAB Production, participe à la création des formats courts et produit de nombreux documentaires pour la télévision. Ses courts-métrages cinéma Comme un Frère de Pascal Laethier, primé au Festival d'.Alès et Départ Immédiat de Thomas Briat, Prix Spécial du Festival du court métrage de Clermont-Ferrand et Grand Prix du Festival de Cabourg ont été sélectionnés dans de nombreux festivals étrangers. Elle a coécrit avec Samra Bonvoisin, L'Aventure du Premier Film aux Éditions Bernard Barrault.
Jean-Yves Charpin, Vice-président de F’A’A – Filmer l’Art et l’Architecture — Chef opérateur et réalisateur, il contribue à la création et à la réalisation de l’émission Capital sur M6, collabore à Lundi Investigation pour Canal+, et sur de nombreux documentaires télévision et cinéma, tel que Mon Maître d’école d’Emilie Thérond. Passionné par l’écologie, il sera, pour France 5, un des piliers du magazine Gaïa. Il a fait l’École Louis Lumière Paris.
SÉANCE
Portrait de l’artiste en pédagogue
Si l’artiste au travail, qu’il s’agisse de l’atelier, du musée, du centre d’art ou de l’espace public, a souvent été l’objet d’une attention de la part des cinéastes, il est un champ qui reste encore peu exploré, à savoir la pédagogie. L’artiste exerce aussi son art par son activité d’enseignement. L’art du vingtième siècle aura été celui de la pédagogie. Il nous a semblé intéressant dans le cadre du Festival Filmer l’art et l’architecture de nous intéresser à cette question. Qu’en est‑il de l’activité pédagogique de l’artiste au cinéma ?
Le programme présente trois situations originales : Séance présentée par Erik Bullot, en présence de Stefano Miraglia, Arnaud Deshayes, et des étudiants, en partenariat avec l’École nationale supérieure d’art de Bourges (ENSA).
Enseignant au Bauhaus, l’artiste hongrois László Moholy‑Nagy s’exile en 1937 aux États‑Unis et fonde à Chicago le New Bauhaus, qui deviendra l’Institute of Design. Il tourne en 1945 un film avec ses étudiants qui témoigne d’une grande invention plastique.
László Moholy‑Nagy (1895‑1946) — Moholy‑Nagy est un peintre, photographe et théoricien hongrois naturalisé américain. Figure du Bauhaus, il a joué un rôle essentiel dans le développement des avant-gardes artistiques et de la photographie expérimentale.
Lors de la venue en 1980 du cinéaste allemand Werner Nekes à Buenos Aires venu donner un workshop, Claudio Caldini filme en Super‑8 des scènes de l’atelier. Ces images témoignent à la fois de la rencontre entre deux cinéastes majeurs de la scène expérimentale, mais aussi de l’importance symbolique de cet atelier en pleine période de dictature en Argentine.
Le film a été soutenu par le Goethe-Institut de Buenos Aires en 1980.
Caméra : Claudio Caldini, Mario Piazza
Montage : Claudio Caldini
Werner Nekes (1944‑2017) — Werner Nekes fut un cinéaste expérimental majeur et un collectionneur passionné d’artefacts pré‑cinématographiques. Cofondateur de la coopérative de Hambourg, il a enseigné dans plusieurs académies d’art et présenté ses films et sa collection dans les plus grands musées et festivals.
Claudio Caldini — Cinéaste expérimental argentin et compositeur de musique électronique, Claudio Caldini est actif depuis les années 1970 dans le Super-8, la vidéo et le « cinéma élargi ». Il a aussi été programmateur au Musée d’art moderne de Buenos Aires et artiste invité dans de nombreux centres internationaux.
Ce film de Paola Anziché et Irene Dionisio tente de reconstituer, à travers des témoignages et de fausses archives, l’enseignement de l’artiste brésilienne Lygia Clark à la Sorbonne à Paris entre 1970 et 1975.
Lygia Clark (1920‑1988) — Artiste brésilienne parmi les plus importantes de sa génération, le travail de Lygia Clark est associé au mouvement néo‑concret. Connue pour ses peintures et ses « objets relationnels », elle a profondément marqué l’histoire de l’art contemporain au Brésil.
Paola Anziché — Paola Anziché est artiste et cinéaste. Diplômée de l’Accademia di Belle Arti di Brera de Milan et de la Städelschule de Francfort, elle développe un travail autour du textile et du tissage, qu’elle transmet dans son atelier The Moving Threads.
Irene Dionisio — Cinéaste et artiste visuelle, Irene Dionisio est diplômée en philosophie et en cinéma. Elle dirige actuellement le festival queer Da Sodoma à Hollywood organisé par le Museo del Cinema de Turin.
Érik Bullot — Cinéaste et théoricien, Érik Bullot a récemment publié Cinéma vivant (Macula), et Pessoa et le cinéma (Quidam, 2025). Son travail, présenté notamment au Jeu de Paume et au Centre d’art Les Tanneries, explore les formes expérimentales du cinéma. Il enseigne à l’École nationale supérieure d’art de Bourges.
Stefano Miraglia — Stefano Miraglia (Málaga, 1988) est un curateur et artiste italo-espagnol basé à Paris. Son travail se concentre sur le film et la vidéo d’artiste. Il est le fondateur et curateur principal de movimcat, un projet en ligne dédié à la diffusion du cinéma d’artiste. Il fait également partie du comité de sélection du Pesaro Film Festival, en Italie, et enseigne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Arnaud Deshayes — Artiste et cinéaste, Arnaud Deshayes a réalisé Black Hole Why I have never been a rose. Il s’intéresse particulièrement au regard documentaire, aux dispositifs, aux effets et à leur écriture et développe des formes parlées. Il enseigne à l'Ecole nationale supérieure d’Art de Bourges.
SÉANCE
Habiter la ville autrement
Le film Espaces Intercalaires réalisé par Damien Faure nous emmène au cœur du « MA », 間, terme japonais qui signifie intervalle. Son idéogramme symbolise un soleil entouré par une porte. Ce terme est employé comme concept d’esthétique, il fait référence aux variations subjectives du vide, comme le silence, l’espace ou la durée et relie deux objets, deux phénomènes, ou deux êtres séparés. Il ne s’agit pas cependant de l’intervalle en soi, mais toujours d’un intervalle dans l’espace‑temps concret. Le MA, entre autres, est présent en architecture, dans les relations amoureuses, dans la nature, et dans le rapport que les hommes ont avec les Dieux.
Séance SensoProjekt présentée par Valérie Barot‑Nouzille et Monica Regas, en présence de Damien Faure.
Production AAA Production.
Le corbeau, le maître de Tokyo, est capable d’appréhender la ville dans sa globalité puis la parcourir dans ses plus petits interstices. Au début, le champ urbain se voit comme un espace à trois dimensions, puis en prolongeant le regard, de nouveaux lieux apparaissent. Tokyo se métamorphose. Ces espaces nous révèlent une vision différente de la cité, peuplée d’architectures singulières et de personnages qui habitent la ville autrement.
Damien Faure — Damien Faure commence sa carrière de réalisateur en travaillant sur une guerre oubliée en Papouasie‑Occidentale. WEST PAPUA, SAMPARI et LA COLONISATION OUBLIÉE, trois films documentaires, naîtront de cette expérience, seront primés dans plusieurs festivals à travers le monde et diffusés sur France Télévisions et ARTE. Entre 2011 et 2016, il réalise un diptyque constitué des films ESPACES INTERCALAIRES et MILIEU qui nous emmène au cœur du « MA », terme japonais qui signifie intervalle. Il co‑réalise pour ARTE Créative une web série sur l’histoire des Shadoks et réalise LE TOUR D’UN MONDE en 2022. Son premier long‑métrage de fiction, PYRAMIDEN, sort en salle en 2024. Il est membre du conseil d’administration de l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion).
Valérie Barot‑Nouzille — Éditrice et programmatrice artistique, Valérie Barot a co‑dirigé avec Yvon Nouzille la Galerie Le Sous‑sol, puis le Centre d’art APDV, à la Porte de Vincennes, accompagnant de nombreux artistes dans des projets poétiques, politiques, parfois pour l’espace public ou pour des projets éditoriaux. Valérie Barot est membre active de SensoProjekt.
Monica Regas — Journaliste, historienne de l’art et commissaire d’expositions, Monica Regas (Barcelone 1964) est également autrice / réalisatrice / productrice de documentaires de création pour la TV et le Web. Actuellement coordinatrice de SensoProjekt.
SÉANCE
Musées palimpsestes
Un musée est un condensé d’histoire(s). Pas seulement celles des objets qu’il abrite, mais aussi de l’évolution des représentations du monde. Les architectures muséales, comme les collections, symbolisent les histoires sociales et politiques des pays. Édifices plus que bâtiments, les musées sont des signes de l’autorité d’une époque. L’universel dont se réclame le musée est une arme de domination quand l’ampleur et le prestige des collections repose notamment sur une histoire de l’art forgée en Occident. Les collections et les architectures s’adaptent aux tournants culturels. Les musées font alors l’objet de refontes et de reprises. La correction de l’histoire de l’art forme, comme le recouvrement en peinture et en gravure, des repentirs et des remords. Le cinéma est alors un outil de recherche et d’enregistrement de ses palimpsestes.
Séance présentée par Sarah Pialeprat en partenariat avec le Brussels Art Film Festival (BAFF).
Scénario de Matthias De Groof, Mona Mpembele et Jean Bofane, image de Matthias De Groof, son de Frédéric Furnelle, montage de Sébastien Demeffe, voix de Jean Bofane, musique originale de Ernst Reijseger. Production Daniel De Valck (Cobra Films).
En 2013, le Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren (Belgique) ferme ses portes pour rénovation. Au-delà du bâtiment, c’est l’esprit du musée qui doit évoluer. Le film nous invite à la table du comité chargé de repenser – et de « repanser » – cette histoire en donnant notamment la parole à la sociologue féministe Gratia Pungu et à l’artiste Toma Muteba Luntumbue. Pendant que les discussions échauffent les esprits, les œuvres emballées et transportées sur des chariots roulants semblent peu à peu s’humaniser. Démonter la statue de Léopold II, symbole d’un passé colonial, proposer une vision plus complète et contemporaine de l’Afrique : telle est la mission de ce « nouveau » musée. Car les explications scientifiques ne suffisent plus à exposer les richesses congolaises ni à éclairer l’histoire. Il est temps d’abandonner le récit de domination pour avancer vers une approche véritablement interculturelle. Et décoloniser un musée, c’est aussi interroger son essence : qui regarde et quelle histoire est racontée.
Matthias De Groof — Cinéaste belge et professeur en études cinématographiques et cultures visuelles, Matthias De Groof travaille depuis 2005 sur les impasses de la décolonisation. Formé en philosophie, études africaines, relations internationales et cinéma, il a d’abord consacré ses recherches à l’eurocentrisme et aux représentations de l’altérité. Il a mené des travaux sur le cinéma africain et la théorie postcoloniale à la NYU (Tisch), au Helsinki Collegium, à l’Université de Bayreuth et à l’Université Waseda à Tokyo. Il enseigne ou a enseigné le cinéma, l’esthétique, la théorie du documentaire et la critique de film. Actuellement chercheur à l’Université d’Amsterdam, il développe un projet sur les esthétiques comme politique des formes. Ses films – dont Under The White Mask (2020), Palimpsest of the Africa Museum (2019) ou Lobi Kuna (2018) – ont été présentés dans de nombreux festivals, dont la Berlinale. Il publie régulièrement dans des revues internationales et intervient comme conférencier, programmateur ou critique.
Sarah Pialeprat — Formée en théâtre et en lettres à l’Université Paris-Sorbonne, Sarah Pialeprat s’installe à Bruxelles en 2000 et s’oriente vers le cinéma documentaire. Elle rejoint le Centre du Film sur l’Art en 2002 et en devient directrice en 2011. En 2013, elle co‑fonde le Brussels Art Film Festival (BAFF), qu’elle dirige à partir de 2016, installant l’événement comme une référence internationale du film sur l’art. Membre depuis 2022 du Film on Art Network, elle poursuit parallèlement un travail d’écriture, avec plusieurs publications à son actif.
SÉANCE
Filmer l’œil qui accumule
Envisager la collection comme une créature, le collectionneur comme son maître. Il m’a semblé que quelque chose d’extrêmement personnel et intime se jouait dans l’accumulation de tous ces objets. Dans quelle mesure une collection est‑elle un autoportrait ? Comme tout portrait, sa représentation a tout à perdre à être exhaustive, ou chronologique, ou informative. Une collection perd-elle son sens avec la disparition du collectionneur ?
Séance présentée par Alyssa Verbizh et Sylvie Boulanger, en partenariat avec Mirage Illimité & la Fondation Antoine de Galbert.
Image de Thomas Lallier, son de Antoine Rodet, montage d’Alyssa Verbizh et Thomas Lallier. Production Mirage Illimité (Dominique Belloir) et la Fondation Antoine de Galbert, avec la participation de Bip TV, du CNC, du Centre Georges Pompidou.
Le film Jean Chatelus, l’œil qui accumule relate l’histoire d’une collection unique en France, composée d’œuvres d’art puissantes et énigmatiques. Il fait, en creux, le portrait d’un collectionneur atypique et passionné, disparu en 2021, et de la relation qu’il entretient avec sa « créature ». Janvier 2022 : le collectionneur Jean Chatelus vient de disparaître à l’âge de 82 ans. Resté sans héritier, il a fait don de sa collection à la Fondation Antoine de Galbert, chargée d’inventorier les œuvres accumulées pendant plusieurs décennies et de décider de leur sort. Dans l’appartement de Jean Chatelus, Antoine de Galbert reçoit les derniers visiteurs comme l’historien de l’art Bernard Marcadé, l’écrivain et psychanalyste Gérard Wajcman, les galeristes Fabienne Leclerc et Éric Hussenot. La Fondation Antoine de Galbert fera don de la collection Jean Chatelus au Centre Georges Pompidou, un ensemble d’environ 600 pièces d’art contemporain, d’art brut, d’art populaire, d’art premier, de livres et d’objets divers. Elle y sera exposée pour la première fois en 2025.
Alyssa Verbizh — Réalisatrice et productrice franco‑autrichienne. Elle a réalisé de nombreux films documentaires, en particulier des portraits d’artistes plasticiens diffusés sur (Arte, France TV…) ainsi que des films en partenariat avec musées et fondations (Centre Pompidou, Fondation Louis Vuitton, MAC/VAL, Maison rouge‑Fondation Antoine de Galbert…). Ses films ont été présentés dans divers festivals internationaux, notamment au FIFA de Montréal, au FILAF à Perpignan ou Arte Cinema à Naples. Elle est également autrice de plusieurs albums jeunesse publiés à L’École des loisirs.
Sylvie Boulanger — Curatrice en art contemporain, Sylvie Boulanger est directrice artistique et programmatrice du festival F’A’A - Filmer l’art et l’architecture, de la Résidence du Château de Moison, co‑curatrice du salon Made Anywhere, conseille trois fondations et collections et a publié plusieurs articles et ouvrages. Elle dédie ses recherches et ses projets aux questions de transmission et de perception dans l’art. Engagée dans les pratiques artistiques les plus actuelles : l’art‑média, la performance, le film, l’art sonore et l’archive, elle développe dès les années 2000 des modèles de diffusion innovants sous la forme d’expositions augmentées de festivals, de résidences et de recherches, souvent dans des lieux insolites et toujours en réseau. Elle a créé la collection FMRA, les salons Light, MAD et Made Anywhere, dirigé l’agence Art public contemporain, le CNEAI et la Maison flottante. Elle publie régulièrement et a mené ses recherches et ses actions depuis le Ministère de la Culture, plusieurs galeries et Fondations non‑profit.
SÉANCE
Portraits sonores
Trop souvent relayé comme composante mineure du film, le son s’associe à l’image pour composer une troisième perception, qui participe pleinement de l’identité du film. Cette séance nous invite à un portrait en creux de trois artistes expérimentaux, pour lesquels le questionnement sur le son est central. Dans le film de Dick Fontaine, ce questionnement s’articule autour de deux approches : avec Rahsaan Roland Kirk celle du son en tant que souffle et avec John Cage l’écoute de l’environnement. Le film se joue, ainsi, en parallèle de ces deux questionnements, l’un le corps et l’autre l’écoute. Ces deux approches, on les retrouve chez Dominique Petitgand dans les voix comme un corps et l’écoute par la manière dont il articule ces voix dans l’espace.
Séance présentée par Anne‑Laure Chamboissier, en présence de Dominique Petitgand.
Image de Bill Breyne et Charles Stewart, son d’Ivan Sharrock, montage de Gene Ellis. Production Tempo ABC TV.
Ce film est un voyage poétique avec Rahsaan Roland Kirk (1935‑1977) et John Cage (1912‑1992), deux musiciens iconoclastes qui cherchent à repousser les limites de leur art. Alors qu’ils viennent de deux domaines assez conformistes : le jazz et la musique contemporaine, ils interrogent par une approche concrète ce qu’est le son dans une succession de plans sur la ville et le zoo. Plutôt que de présenter une collaboration directe, le film alterne des scènes de Cage et Kirk, soulignant leurs approches distinctes mais complémentaires du son et de la performance. John Cage prépare une performance impliquant un « vélo musical » aux côtés du pianiste David Tudor et du chorégraphe Merce Cunningham au Saville Theatre de Londres. Il nous plonge dans ses explorations du silence et du bruit ambiant, y compris dans une chambre anéchoïque où il réfléchit aux sons internes du corps humain. À l’inverse, les performances dynamiques de Kirk sont présentées à travers des images du jazz club de Ronnie Scott et une séance impromptue au zoo de Londres. Connu pour sa capacité à jouer plusieurs instruments à vent simultanément, les segments de Kirk le montrent engageant le public par la distribution de sifflets. Bien que les deux musiciens iconoclastes ne se rencontrent à aucun moment du film, ils partagent une même vision des possibilités illimitées de leur art.
Dick Fontaine (1939‑2023) — Les films du britannique Dick Fontaine sont autant de documents uniques sur la culture occidentale et ses mutations. Depuis les années 60, il utilise les techniques du cinéma direct pour capter les soubresauts politiques et musicaux de son époque, de la lutte pour les droits civiques aux États‑Unis à la guerre du Vietnam, de l’invention du free jazz à la naissance du hip‑hop. Il a enseigné à la School of Visual Arts et à NYU à New York. Fontaine réalise un nombre important de films sur le jazz contemporain et notamment sur Ornette Coleman (1966), Sonny Rollins (1968), Betty Carter et Art Blakey (1986/1987), aussi bien que des films sur la pop ou la Beat en filmant des auteurs tels que James Baldwin, Norman Mailer ou Black Panther George Jackson.
Vidéo, texte, pièces sonores et musiques de Dominique Petitgand, voix de Liza Maria Riveros, Paoulo Riveros, Bénédicte Petitgand et Dominique Ané, photographies de Madeleine Decaux au Yachting Club d’Arromanches (Route Panoramique, 2017), photogramme issu d’une vidéo privée de Jean‑Pierre Auvy (Arromanches, années 80).
La vidéo a été conçue lors d’une résidence à la Villa La Brugère en 2017. Cette création sonore cinématique joue sur les apparitions et disparitions de voix, mots, lettres et leurs coïncidences avec les images de paysages, faites de vagues, d’embruns et de sable. Dans un rythme à peine perceptible, le brouillard se lève, et le sens se défait et se refait accroché au développement d’une phrase. Le film nous amène dans l’entre‑deux du montage et crée des accroches sur notre attention, sans cesse renouvelée par le jeu des correspondances musicales, verbales et fictionnelles. « L’élément déclencheur de ce montage de textes, d’images et de sons est, selon Dominique Petitgand, une coïncidence à trois têtes, liée au paysage d’Arromanches et à la Route Panoramique où j’ai présenté une série de diffusions sonores face à la mer. Le fil conducteur des séances était une suite de voix, guide en pointillé d’une déambulation parmi les décombres d’un paysage rêvé. L’une de ces époques et réalités est, enfin, liée au troisième terme de la coïncidence : le paysage même des étés de mon enfance, les pieds nus, le temps aboli et les allers-retours de la digue à la mer ».
Dominique Petitgand — Dominique Petitgand crée des œuvres sonores, où les voix, les bruits, les atmosphères musicales et les silences construisent, par le biais du montage, des micro‑univers. L’ambiguïté y subsiste en permanence entre un principe de réalité et une projection dans une fiction possible et atemporelle. Il a exposé notamment au CIAP (Vassivière), à l’Abbaye de Maubuisson, au Musée des Beaux‑Arts de Nancy ou encore au MUDAM (Luxembourg). On trouve ses œuvres dans plusieurs collections dont le PEAC Museum (Allemagne), au Musée des Beaux‑Arts de Nancy, au CNAP, dans plusieurs FRAC (France) et dans des collections privées.
Anne‑Laure Chamboissier — Historienne de l’art et commissaire d’exposition, Anne‑Laure Chamboissier crée en novembre 2013 ChamProjects, structure dédiée à la réflexion transversale autour de la question du son et de sa relation avec d’autres disciplines : cinéma, arts visuels, littérature, ainsi qu’à des projets spécifiques d’art contemporain in situ. Son travail prend la forme d’expositions (Exposition de Myriam Pruvot “Chants éloignés” 2024, « Más allá del Sonido », Buenos Aires 2016 ; « OOOL‑Sound Fictions », Kunsthalle Mulhouse, 2016 ; « Beyond the Sound », Hong Kong, 2015…), de programmations artistiques (FIAC, 2014 et 2015 ; LOOP, Madrid, 2015…), de publications, films (Qu’est‑ce que la musique fait à la littérature, 2025 ; Poésie action – Variations sur Bernard Heidsieck, CNAP / a.p.r.e.s éditions, 2014 ; Entretien avec Jean‑Michel Espitallier, site Les Archives du Présent, 2016…) et de conférences. Elle est membre de l’AICA, de C.E.A. Elle est actuellement commissaire artistique du festival AR(t]CHIPEL, médiatrice pour la Société des Nouveaux Commanditaires en Région Centre‑Val de Loire et fait partie du pôle des commissaires pour Bourges, Capitale européenne de la Culture.
SÉANCE
Vie et vision d’artiste
Questionnement sur la transmission entre générations, entre artistes de différentes origines, le film Andreï Roublev est avant tout un magnifique exemple d’une réflexion sur la place de l’artiste dans la société, une société troublée par une sorte de guerre civile entre clans rivaux, soumise à des incursions étrangères comme l’était la Russie de ce temps.
Séance présentée par Jean Radvanyi, en partenariat avec le Festival du Film Russe “Une autre Russie”.
Production Mosfilm. Avec Anatoli Solonitsyne, Ivan Lapikov, Nikolaï Grinko, Irina Raouch, Rolan Bykov.
Russie, début du XVe siècle. Les princes s’entretuent alors que les Tatars mettent le pays en coupe réglée. Partout, la désolation et les pillages ravagent le pays. La foi vacille. Au milieu de ce désordre, le moine Andreï Roublev se demande pourquoi continuer à peindre des icônes. Face à la barbarie et au silence de Dieu, l’art a‑t‑il encore un sens ?
Andreï Tarkovski — Andreï Tarkovski réalise sept longs‑métrages qui le placent parmi les maîtres du septième art et parmi les plus grands réalisateurs soviétiques. De L’Enfance d’Ivan à son dernier film, Le Sacrifice, Tarkovski aura filmé des visions et des rêves, des gestes et des conversations. Un cinéma sensitif qui va se heurter très vite aux carcans de l’idéologie soviétique de son temps jusqu’à le forcer à l’exil. La poétique inhérente à ses films le relie à son père, Arseni Tarkovski, journaliste, traducteur et poète. Ses films révèlent une poétique et une spiritualité qui se fondent malgré tout sur la vie matérielle. Il n’y a donc pas à s’étonner que la création et les questions existentielles se manifestent de façon saisissante dès son deuxième film, Andreï Roublev.
Jean Radvanyi — Géographe et professeur émérite à l’INALCO (Langues O), Jean Radvanyi s’est spécialisé dans l’étude de la géopolitique et des cinémas de Russie et de l’espace post‑soviétique, en particulier du Caucase. Avec Macha Méril et Marc Ruscart, il crée en 2015 le Festival de cinéma russe de Paris / Île‑de‑France “Une autre Russie”. Il a notamment publié Le cinéma géorgien (Centre Pompidou, 1988), Le cinéma d’Asie centrale soviétique (Centre Pompidou, 1991), Le cinéma arménien (Centre Pompidou, 1993), Russie, un vertige de puissance (La Découverte, 2023).
HORS LES MURS
Galerie François Ier
Exposition à la Galerie François Ier de films et vidéos en accès libre
Faut-il détruire les antiquités ? Les statues sont-elles condamnées à rester immobiles ? Sommes-nous devenus immobiles à notre tour ? Sous la forme d’un film-essai, qui croise le journal filmé, l’écriture documentaire, la comédie musicale et le micro-trottoir, ce film choral, tourné à Athènes, interroge la possibilité de réécrire l’Histoire.
Daphné Hérétakis — Daphné Hérétakis a fait des études de cinéma à l'Université de Paris 8 où elle a obtenu un Master de réalisation documentaire ainsi qu'au Fresnoy, studio national des arts contemporains. Ses films, à la lisière entre documentaire et fiction, tissent des récits entre l'intime et le collectif et ont été projetés à de nombreux festivals tels que La Semaine de la Critique à Cannes, New Directors/New Films, IFF Rotterdam, Sarajevo Film Festival, Visions du réel, etc.
Mêlant animation et prises de vue réelles, ce film montre des paysages naturels en transformation tandis qu’une voix féminine confie un récit intime, impudique et libre, sur son activité de travailleuse du sexe. Sous les métamorphoses, le récit d’une liberté conquise.
Sylvain Derosne — Réalisateur, chef animateur, directeur des effets spéciaux, anime depuis près de 10 ans. Formé à l’animation à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), il s’est ensuite spécialisé dans le volume animé. Il fait ses premiers pas en tant que chef animateur sur le court métrage Mourir Auprès de Toi de Spike Jonze. Il travaille depuis en étroite collaboration avec l’équipe de Manuel Cam Studio à Paris, sur divers projets : publicités, clips, courts métrages, séries, long métrage (L’écume des jours de Michel Gondry). Il anime en volume et banc-titre : marionnette, objet, papier découpé. En 2014, Sylvain co-réalise avec Sébastien Laudenbach le court métrage Daphné ou la belle plante, qui remporte plusieurs prix, dont le prix Emile Reynaud.
Sébastien Laudenbach — Réalisateur de films d’animation et illustrateur. Auteur de 10 courts métrages, dont Journal, Des câlins dans les cuisines Vasco, Daphné ou la belle plante et Vibrato (3e Scène – Opéra de Paris), ainsi que de 6 films-de-poésie en collaboration avec Luc Bénazet. Son travail a été sélectionné et primé dans de nombreux festivals (Annecy, Cannes, Clermont-Ferrand…).
Auteur de performances d’animation en direct, il est représenté par la galerie Miyu et expose à la Drawing Now Art Fair en 2022. Il enseigne à l’EnsAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) depuis 2001 et développe actuellement un nouveau long-métrage d’animation : Prends garde à toi !, librement inspiré de Carmen et produit par Folivari, qui sortira sur les écrans en 2026.
Installation filmique : mécanismes de boîtes à musique, bandes de photographie perforées ; planches de résonance en bois ; à activer. Les perforations sont la traduction en notes de musique de la voix de ma grand-mère parlant l’arabe.
Ma grand-mère parle peu le français et je ne parle pas l’arabe. Ses paroles en arabe sont traduites en notes de musique puis transposées ici sous la forme de perforations effectuées dans trois photos des archives familiales. Celles-ci représentent ma grand-mère, ma mère et moi-même. La possibilité d'une traduction sensorielle et d'une communication non verbale m'intéressent ici ainsi que l'idée de la transmission entre les générations par le moyen d'une transposition. Il importe aussi que les trous dans les images créent le son. Cette installation est un film. Vous pouvez l’activer si vous le souhaitez.
Série Intérieurs – Troisième volet
Vidéo / Couleur / Sonore / Projection
Mon travail s’inscrit dans des espaces dûment choisis. Maison familiale ou résidence pour personnes âgées. Installations et films deviennent des outils pour mieux saisir, archiver et restituer l’histoire de ces lieux. Entre trace et oubli, je m’interroge sur ce qu’il en est, sur ce qu’il en reste. Après avoir réalisé une série d’images des chambres des résident.e.s de l’Ehpad Bellevue à Bourges, j’ai proposé un atelier film avec celles et ceux intéressé.e.s, ce qui a permis l’élaboration de ces images.
Informations
Contacts
Partenaires
PARTENAIRES OFFICIELS
Ville d’Aubigny-sur-Nère
Direction régionale des affaires culturelles – Préfet de la Région Centre‑Val de Loire
Conseil départemental du Cher
Région Centre-Val de Loire – Nouvelles Renaissances
Communauté de Communes Sauldre et Sologne
Berry Province
Tourisme et territoires du Cher
Château de Moison
PARTENAIRES ARTISTIQUES
ENSA Bourges
Galerie Capazza
JAP (association Jeunesse et Arts Plastiques)
Allons Voir !
Association A.R.T.
Brussels Art Film Festival (BAFF)
SensoProjekt
Musée du Louvre
PARTENAIRES PROJETS 2025
France Bleu Berry
BIP TV
Isa Groupe
Fondation du Crédit Agricole
Philippe Guiot, Imprimeur
Domaine Guillerault-Fargette Sancerre
Domaine Adèle Rouzé Quincy
Domaine Jacques Rouzé Reuilly
Les Sablés de Nancay
Emmanuelle Loze, Traiteur
Comité artistique
Valérie Barot-Nouzille
Éditrice et critique
Erik Bullot
Cinéaste, critique et enseignant
Anne-Laure Chamboissier
Commissaire d’exposition et historienne d’art
Sarah Pialeprat
Directrice du festival BAFF Brussels Art Film Festival et du centre du film sur l’art de Bruxelles
Jean Radvanyi
Professeur émérite, spécialiste en géopolitique et cinéma de la Russie et président du Festival du Film Russe “Une autre Russie”
Pascale Raynaud
Responsable de programmation au Musée du Louvre
Monica Regas
Autrice et commissaire d’exposition
Alyssa Verbizh
Réalisatrice
Comité de programmation
Sylvie Boulanger
Directrice de programmation du Festival F’A’A
Mary-Anne de La Palme Présidente de F’A’A
& Jean-Yves Charpin Vice‑Président de F’A’A
Directeurs du programme Territoires
Équipe
Amélie Boulin, Anne Bauer, Marie Follet, Juliette Karpa, Michel Karpa, Andréa Martin‑Negri, Guillaume Penicaut, Cécilia Verdy
Équipe culture Aubigny‑sur‑Nère
Julie Benzerakk, Alexandre Mulot, Julie Raffestin, Margaux Duval
Le Festival F’A’A – Filmer l’Art et l’Architecture – est produit par l’Association F’A’A, c/o Mairie d’Aubigny‑sur‑Nère, 5 place de la Résistance 18700 Aubigny‑sur‑Nère